Retailles, c’est chez moi. J’y respire bien, j’y suis à mes aises, libre. Mais j’aime aussi aller prendre de grandes marches, et aujourd’hui, pour la quatrième fois, c’est chez Ricochet que je suis allé défendre mes gros sabots. Vous pouvez me lire en suivant ce lien.
Le dernier cadeau

Cette année là encore, je ne dormais pas. Ma mère m’avait prévenue pourtant : C’est ton dernier biscuit. T’as déjà mangé trop de sucre pour ce soir. Je veux bien croire que c’est Noël, mais si tu veux être en forme demain… Renaud, cet homme qui n’était pas mon père mais qui aimait ma mère, m’avait tendu deux autres biscuits sous la table, me faisant un clin d’œil. J’avais presque vidé la jarre de biscuits au pain d’épice, et c’est le ventre ballonné que j’avais gagné mon lit. Plusieurs heures plus tard, après d’innombrables décomptes de moutons, j’étais toujours éveillé. Ces cadeaux qui patientaient sous le sapin n’aidaient pas, si bien qu’au beau milieu de la nuit, j’avais les deux yeux ronds comme ceux de ce bonhomme de neige dehors.
Le père Noël est arrivé à la même heure que l’année précédente, soulevant doucement le loquet de la porte arrière de notre petit appartement fait sur le long. À la cuisine, la même odeur de menthe, se mêlant à celle de gingembre et de clous de girofle. Il marchait furtivement, arpentant le corridor en prenant soin de ne pas accrocher les cadres sur les murs. Sous ma porte, malgré la noirceur, l’ombre est passée sans s’arrêter. C’est devant la chambre de ma mère qu’il s’immobilisa, posant son oreille sur le silence de la porte fermée, puis retenant son souffle pour le mettre au diapason de celui de ma mère, endormie dans son lit. Pour un instant, sa respiration fut plus calme. Mais elle devint bruyante et saccadée au moment où il reprit sa marche vers le salon, presque maladroitement, comme étourdi.
En arrivant près de l’entrée avant, une légère brise de vanille a caressé ses sens, venant du portemanteau. Rien n’avait changé dans la dernière année. Simplement, un peu de poussière s’était posée sur cette photo dans le cadre noir, sobre à côté du grand miroir de l’entrée, où ma mère reposait, magnifique, dans les bras d’un Renaud tout sourire. Le père Noël a cessé de respirer, secoué.
Les pas suivants ont été pénibles et il s’est retrouvé au milieu du salon le dos courbé, essoufflé. L’odeur du sapin frais prenait toute la place et celle de la résine lui picotait le nez. Les lumières de Noël s’illuminaient par intermittence, venant s’imprimer sur son visage : vert, blanc, rouge. Il allait faire un geste pour débrancher l’alimentation des lumières, afin d’éviter les risques d’incendie, mais il s’était promis de ne laisser aucune trace de son passage. Sauf ce cadeau, dans ses mains.
Il s’en voulait d’être là. Il n’aurait pas dû. Il avait promis, d’ailleurs. De ne plus forcer la porte, de se glisser dans l’intimité de cet appartement avec son gros sac bourré de promesses, rempli de souvenirs, et d’entretenir des espoirs perdus avec de nouveaux cadeaux. Mais quand cette broche lui était apparue dans la vitrine d’une boutique, il n’avait pu résister. Cette broche toute simple, une petite feuille allongée taillée dans le cuivre, un peu ondulée, il la voyait s’accrocher dans les branches fines de ses cheveux. Cette broche, c’était son nez, ses mains, qui pourraient se blottir, comme une caresse, dans la chevelure de cette femme qu’il aimait. Sa promesse de ne plus la voir n’avait aucun sens après tout : il avait acheté la broche et attendu ce soir avec impatience. Je ne savais pas s’ils s’étaient revus depuis l’année précédente, quelque part entre le pôle Nord et notre salon, et j’ignorais si Renaud savait pour cette nuit où le père Noël avait pris sa place. Mais il était là, à quelques pas du sapin, une petite boîte emballée dans le creux de ses larges mains, quand ma mère est arrivée à sa hauteur.
Elle l’a d’abord dévisagée avec reproche, mais très vite ses sourcils se sont adoucis, puis elle l’a regardée tendrement, la bouche muette. Dans ses yeux, les étoiles s’ajoutaient à celle qui était juchée sur la plus haute branche du sapin. Le sommeil froissait la peau de ses joues, le coin de ses yeux. Elle avait traîné l’arôme de vanille avec elle.
Plantés l’un devant l’autre, les lumières rigolaient sur leur visage comme sur les guirlandes du sapin, accompagnées d’un léger grésillement électrique. Dans leur retenue fébrile, j’ai compris que Renaud ne savait pas. C’était écrit, il suffisait de lire le creux de leurs yeux, la frontière de leurs lèvres. Aucun d’eux n’avait oublié, c’était visible, le souvenir de ces baisers, le souffle de cette nuit et la rosée du lendemain matin. Séparés par une longueur de bras, par ce petit quelque chose qui les retenait et les unissait, tout à la fois, ils couvaient, dans la morsure de leur silence, un mensonge. Un petit mensonge humain, séculaire et anodin. Immense. Il scellait ensemble les lèvres de ma mère, retenait les mains de cet homme. La foudre était aux aguets, prête à s’abattre, mais l’éclair ne viendrait pas. Dans la pièce à côté, dans le lit abandonné par ma mère, un autre homme dormait, à l’abri du mensonge.
Puis ils ont chuchoté quelques mots, insaisissables, qui allaient danser encore longtemps dans leur tête, tandis que les étoiles s’amusaient dans leur regard. Le père Noël a fait quelques pas, sans s’arrêter dans les bras de la femme qu’il désirait. Il a posé la petite boîte emballée au pied du sapin, secouant malgré lui les branches de l’arbre. Pas une fois ma mère n’a bougé, restant dans le chambranle de la porte, incertaine, secouée et figée.
Le père Noël est sorti par l’avant et quand il a refermé la porte derrière lui, elle était encore là, immobile jusqu’au bout de ses lèvres, habitée par un mensonge. Un autre, moins laid, mais aussi terrible. Celui d’aimer en secret.
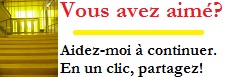
Vendredis-moi tout #2

Quatre ans, c’est ce qui nous sépare de son premier album, Un an debout. Presque rien, à peine le temps de se revirer de bord, de découvrir un cheveu gris, de souffler quelques fois sur les bougies, le cœur gonflé d’espoir pour l’année à venir. Aux portes de St-Pierre, ce n’est rien. Et pourtant, quatre ans, c’est un monde en soi. C’est assez pour s’asseoir, épuisée, tenter de se relever, ne pas y arriver et s’étendre, plutôt. Mais parce qu’en Flavie, il y a une artiste, une force sensible qui embrasse les marées en les faisant chanter, qui apprivoise les bêtes en les faisant écrire, ces quatre années l’ont mené à ce nouvel album, Brûler dehors, qu’on écoute comme on regarde les flammes d’un feu de camp : envoûté.
C’est une Flavie fidèle à elle-même qu’on a retrouvée sur scène lundi : entière. Il y avait une paix retrouvée dans ses mots, une maturité dans sa posture. Et toujours, ce charisme, cet humour, ce laisser-aller, sur les planches d’une scène comme chez elle, retrouvant un dialogue avec son public qui semble n’avoir jamais été interrompu.
Il est vrai que Flavie est remontée sur les planches depuis quelque temps déjà, entourée de ses complices des Bouches bées, qui vivent de beaux moments, notamment depuis la sortie de leur premier album, Au fil des avenues. Et puis, même avec Brûler dehors, Flavie n’est jamais seule. Avec elle, toujours : Catherine Leblanc-Fredette et David Bujold, ensorceleurs d’âme eux aussi, partenaires des premiers jours.
Brûler dehors arpente la douleur des départs, les revers de la médaille, les petites et grandes peurs du chemin, avec une force tranquille, une douceur de feu de camp. Campées dans des textes étoffés, alimentées d’images fortes, ses chansons portent l’imaginaire de la gravité terrestre jusqu’aux failles du ciel, où l’on prend notre envol, avec elle.
Ce second album n’efface rien de ces quatre dernières années. Au contraire, il transcende la vie, dans sa sueur et ses peines, la ramenant sur le chemin de la beauté. Et quand, au terme du jour, il est temps de retrouver la paix de l’oreiller, il reste le souvenir de ces envols, comme une arme pour confronter nos démons : « Je voudrais t’avoir au bout du fil / ferme mes yeux / les monstres s’en moquent et font la file / au bout du lit ».
La vie comporte son lot de drames et nous portons en nous le fardeau de la mort. Et tandis que les ficelles de la folie se jouent parfois de nous, la beauté est là, toujours, dans le chant des oiseaux, le calme du fleuve, la solidarité humaine. L’amour. Anne Émond signe ici un second long métrage, intime et généreux, planté dans le décor troublant et magnifique de Notre-Dame-du-Portage.
Il y a là les ébats de toute une génération, non pas coincée dans sa misère, mais plutôt ouverte au legs de celles qui l’ont précédée. Celle de ce père, David, sensible, généreux et rassembleur (Maxim Gaudette, mature et humble : grand) qui se nourrit de la paix des siens pour lutter contre ses fantômes. Celle de ce grand-père, qui ouvre le film dans une scène poignante, pendu. De cette grand-mère qui instille sa force chez ses enfants, malgré sa discrétion.
L’héritière, Laurence, c’est cette jeune fille qui devient femme (Karelle Tremblay qui se révèle magnifiquement à nous), portant plus loin la sensibilité de son père, s’en servant comme d’un levier pour s’émanciper et non plus pour se refermer sur elle-même. Cette femme confronte le silence et persiste dans la beauté.
Car la beauté est dans chaque plan, même si celle-ci est parfois doublée de la tourmente. Les mots de Vigneault sont là pour nous le rappeler : « J’ai planté un chêne / au bout de mon champ / perdrerai-je ma peine / perdrerai-je mon temps ». Les univers sont bien campés. Celui de David, son bois, où il y est, à l’instar des lièvres, vulnérable dans la sagesse ancestrale des arbres. Ou son atelier où il crée ses petites marionnettes qui, dans une sombre ironie, pendent au bout de ficelles. Celui de Laurence, elle aussi épongeant la charge du monde, mais se découvrant libre à l’aventure, habile à décharger sa sensibilité dans la création. Celui du clan, de la famille où, malgré le choc des personnalités, naît la solidarité humaine.
Dans ce grand film fait de petites choses, de détails parfaits, nous restons sur l’équilibre fragile du bonheur, tiré par la force aliénée des marées, mais porté par le vent, dans le chant acharné des oiseaux, migrant d’un univers à l’autre, ensemble.
Vendredis-moi tout

Crédit photo: Michel Hébert
Évidemment, votre pile de livres à lire déborde sur votre table de chevet, vos amis vous ont parlé de tant de films à voir qu’une fois au club vidéo, votre cerveau sature et vous êtes incapable de vous rappeler ne serait-ce que d’une recommandation. Faisant fi des promesses déjà trop nombreuses que vous vous êtes faites à vous-même de lire ce livre ou de voir ce film, je prends sur moi d’ajouter à cette liste. Par la chronique « Vendredis-moi tout », je m’engage à vous faire saliver l’intellect et vous émoustiller les sens en vous proposant mes récents coups de cœur. Reste à voir si, comme vous, je tiendrai mes promesses.
Dans une salle près de chez vous

Democrats
Zimbabwe, 2008. Une élection controversée contraint Robert Mugabe (ZANU-PF), président autocrate depuis l’indépendance du pays en 1980, à former un gouvernement de coalition avec le Mouvement pour le changement démocratique (MDC) de Morgan Tsvangirai. En dépit d’un climat qui demeure très tendu, où la violence systémique et des enlèvements ciblés perturbent toujours le quotidien, le gouvernement forme un comité mandaté d’écrire la première constitution du pays. Le documentaire suit les deux leaders de ce comité, Paul Mangwana et Douglas Mwonzora, tous deux avocats et respectivement émissaires du ZANU-PF et du MDC.
La réalisatrice danoise Camilla Nielsson, qui a notamment réalisé des reportages dans des circonstances difficiles en Afghanistan et au Darfour, profite ici d’un accès inouï au processus de négociation. Nous assistons ainsi à une lutte de pouvoir inédite, où Mwonzora fera tout pour profiter de cette fenêtre d’espoir vers la libération de son pays et où Mangwana tentera d’honorer les vœux d’un dictateur tout en se prêtant au jeu de la démocratie. Ils seront tour à tour emprisonnés et menacés de mort, parvenant néanmoins à la signature d’une constitution – ratifiée mais toujours pas honorée par Mugabe –, signant du même élan les premiers traits de leur amitié.
Democrats est un récit essentiel, qui rappelle la difficulté de changer le cours des choses, mais aussi sa possibilité. Saisissant et enlevant, il est le témoignage de tous ces combats menés dans l’ombre, le rappel d’un monde où tous les possibles sont envisageables.
Votre prochaine lecture

L’année la plus longue
Les premiers romans nous intéressent parfois pour de mauvaises raisons. Mû par le désir de découvrir un écrivain en herbe, curieux de savoir ce qui habite la nouvelle génération d’écrivains. Avec ce premier roman, Daniel Grenier nous rappelle que même des premiers pas peuvent nous mener très loin.
L’année la plus longue raconte l’histoire du leaper Aimé Bolduc, né un 29 février et investi du pouvoir de ne vieillir qu’une fois aux quatre ans. La proposition est belle et nous fait voyager de Chattanooga à Sainte-Anne-des-Monts, en passant par Québec et Montréal, à cheval sur les grands événements. Tour à tour contrebandier d’alcool, soldat, inventeur et amoureux, Aimé marche dans les pas de la grande histoire, la convoquant pour écrire la sienne, tout aussi grande mais plus secrète. Intime.
Grenier nous offre ainsi une épopée qui se garde de trop de lyrisme, s’appuyant sur les rencontres tendres qui tissent une vie d’homme. Le style y est ample, généreux, mais ciselé et précis, laissant notre imagination divaguer au gré des images, des ambiances et des décors qui peuplent le récit, qui nous font rêver. « Une histoire inoubliable de vies trop courtes et de vies sans fin » : à lire!
Redécouvertes
Hungarian melody D.817
Il nous semble parfois que les jours manquent d’heures, les heures de minutes et nos nuits, de sommeil. Il nous semble qu’avec une heure de plus ici ou là, on pourrait enfin accomplir de grandes choses. Mais il y a ceux qui, dans le cubicule du temps, y arrivent. Mathieu Gaudet a une triple formation : chef d’orchestre, médecin pratiquant et pianiste émérite, il est un ouvroir temporel, un artiste généreux. Après nous avoir envoûtés par ses récentes propositions de Schumann et Rachmaninov, il nous offre ici une brillante interprétation de Schubert.
Dehors novembre, et pourtant, il fait doux. La brise vous caresse les tempes, retroussant vos tifs. Une pluie tombe en vagues continues, créant un rideau qui semble s’ouvrir et se refermer sans cesse, dans le repos de vos yeux. Inlassable et répétitive, la pluie. Un contemporain vous dirait : voilà un beau .gif. Dans vos oreilles, Schubert. Le maître de votre bien-être, Mathieu Gaudet. Son doigté nous rappelle ici que rien ne presse. Les notes retombent sur vous dans la gravité légère de la danse et vous bercent. Rien ne presse, disais-je, sous l’emprise de Mathieu Gaudet, ouvroir temporel.
Maintenant, allez remplir vos promesses et revenez me dire ce que vous en avez pensé.
Vers libres pour une pomme pourrie
Il n’avait pas franchi le pas de la maison, celui qu’à l’époque on appelait simplement monsieur.
Cet homme qui avait pris le temps de repasser sa chemise le matin même. Il avait même enlevé un à un les poils coriaces de son chat, Renoir, sur les manches de son veston. Il s’était assuré que la ligne de pli de son pantalon était bien droite, que la boucle de ses lacets était égale de chaque côté. Pas un instant il n’avait hésité à mettre une cravate, faisant un nœud parfait avec fierté, puis il était parti. Sans même un regard à son miroir : il savait qu’il était parfait.
Il n’avait pas franchi le pas de la maison, quittant quelques minutes plus tard sans offrir de poignée de main. La porte s’était ouverte devant lui et l’odeur de l’appartement lui avait soufflé le visage. L’odeur d’un foyer. Il avait passé quelques minutes dans le cadre de la porte, répétant son nom le plus souvent possible. Quand il parlait, on l’écoutait. Même lui, s’écoutait. Puis on refermait la porte derrière lui et le citoyen restait avec l’impression que cet homme avait parlé en se bouchant le nez.
Il était resté sur le pas de la porte et était parti sans offrir une poignée de main, à cette époque où on l’appelait encore monsieur. Celui qui s’est retrouvé dans une chaise de ministre pour les mauvaises raisons. Il l’a su tout de suite quand il s’est assis dans son siège. Ses doigts avaient filé sur le bois travaillé de la chaise, appréciant la façon dont on avait léché la matière : c’était doux. Son siège. Le président d’assemblée avait dit Ministre en se tournant dans sa direction. Et il s’était gonflé d’orgueil.
Le citoyen restait avec l’impression que cet homme lui avait parlé en se bouchant le nez, celui qu’on appelait désormais ministre. Cet homme qui aujourd’hui les humiliait publiquement, leur rappelant la force de son poing et son entêtement à servir ses frères de boire. Celui qui plaçait nos coffres dans la promesse du paradis, celui que jadis on appelait simplement monsieur, créait des exilés en leur propre pays.
Le pas de la maison, c’est encore eux qui devraient le franchir.
Et le lendemain, celui qui n’est plus rien d’autre que ministre nous invitera à une minute de silence devant la tragédie humaine.
Si par une nuit banale un grand livre
La plupart du temps, quand vous lisez, c’est dans ce fauteuil que vous êtes assis. Il vous arrive de voler quelques moments de lecture ailleurs, sur le banc d’un métro ou attablé dans un café, c’est vrai. Mais ce moment-ci, vous l’avez préparé : il reste deux chapitres au roman qui a traversé la semaine avec vous. Malgré les aléas du travail, dans les plaintes et les rires de vos enfants, dans ces douces minutes qui précèdent le sommeil, contre cet idiot qui vous a envoyé le doigt d’honneur parce que vous rouliez en vélo dans la rue : ce livre vous a accompagné. Parce qu’une histoire qu’on aime, qu’on soit en train de la lire ou non, est avec nous.
Ce soir, dans le calme retrouvé de la ville, dans la noirceur de l’appartement, posé contre la douche de la lumière de lecture, vous êtes assis dans votre fauteuil, pour profiter des derniers moments de votre livre. Les pages s’égrainent rapidement et arrivé au dernier chapitre, vous jaugez la quantité de pages restantes, faisant une moue triste devant la conclusion prochaine de votre plaisir. Les derniers moments sont parfaits. Il n’y a pas de retournement farfelu et les mots sont soufflés à votre oreille dans un rythme parfait. L’histoire se conclut doucement, comme elle a commencé. Puis vous lisez : « Tout est bien. Il dort pour de bon. Le Vieux, là-haut, a tourné son pouce vers le bas.[1] » Ce n’est pas écrit FIN, il n’y a qu’un long blanc sur la page dans lequel votre esprit vagabonde. Le temps passe et le récit défile en vous, posant un sourire sur vos lèvres. Vous tournez la page, irrésolu à fermer le livre : un autre blanc. C’est bel et bien fini et dans ce blanc commence un petit deuil. Enfin, le livre se referme dans vos mains et vous le posez en promettant de le relire, bientôt.
Vous auriez aimé en parler à tout le monde, de ce livre. Vous avez d’ailleurs cherché à convaincre quelques collègues que c’était le roman de l’heure, adaptant chaque fois votre discours à votre interlocuteur pour vous faire plus convaincant. Avec elle, vous avez vanté la proposition, étonnante et prometteuse, avec lui vous avez mis de l’avant le style, vif et ample à la fois. Mais autour de vous, personne ne lit. Ou alors tout le monde lit, mais il y a tellement de livres à lire. Trop, dirait l’autre. Résigné, vous googlez le titre et parcourez les commentaires de quelques inconnus : voilà l’échange le plus substantiel que vous aurez sur ce chef d’œuvre qu’on aura oublié demain.
Heureusement, il existe un autre scénario imaginable. Car en refermant Évariste, en me laissant imprégner de la grande sortie de La terre sous les ongles, en reprenant mon souffle avec Buvard, en retrouvant le moment présent à la tombée de L’année la plus longue, l’aventure ne faisait pour moi que commencer. Pour une deuxième année, je participe en effet au club de lecture de l’UNEQ, dans le cadre du festival du premier roman Chambéry.
Créé en 1987 dans la région de Savoie, le festival récompense chaque année deux primoromanciers, l’un-e français-e, l’autre québécois-e. Le mode de scrutin, unique dans le paysage des prix littéraires, fait du bien. Celui-ci invite en effet des lecteurs, lectrices de tous horizons à se rencontrer en clubs de lecture pour discuter des œuvres lues. Cette année encore, trente primoromans – 15 québécois et 15 français – ont été présélectionnés et proposés en lecture aux clubs. À la fin du processus, chaque club établit ses romans préférés qui reçoivent, dans l’ordre, un pointage. Les résultats sont colligés et le/la lauréat-e français-e est invité-e au festival Metropolis bleu, tandis que celui/celle québécois-e visite le festival de Chambéry. Le volet québécois ayant été créé il y a trois ans à l’initiative de Marine Gurnade, de la librairie Gallimard, le Québec a chaque année triplé son nombre de clubs, en totalisant maintenant neuf. Au total, ce n’est pas moins de 3200 lecteurs, lectrices qui élisent les gagnants, éparpillés dans des clubs majoritairement en France, mais installés un peu partout en Europe et au Québec.
L’ambiance d’un club est singulière. Il faut imaginer une douzaine de personnes se réunissant, au départ inconnues les unes des autres. Les raisons qui poussent les gens à joindre les clubs sont diverses, mais une chose les unit essentiellement : la passion de la lecture. Au fil des rencontres, les caractères se dévoilent : l’humour, la sensibilité, la fébrilité des clubistes se révèlent, et grâce aux livres les inconnus n’en sont plus. De ces échanges naît une solidarité, un plaisir d’être ensemble, de faire résonner encore plus fort la puissance de la littérature.
Pour chaque édition, un événement réunit lecteurs et primoromanciers, suivant ainsi la volonté originale de Jacques Charmatz, enseignant de Chambéry et instigateur du projet en 1987, qui cherchait une façon originale d’encourager ses élèves à la lecture. Cette année, le rendez-vous aura lieu au Salon du livre, le jeudi 19 novembre, à 19h45. Vous y êtes cordialement invités. Parce que la littérature, c’est avant tout une grande rencontre.
[1] DÉSÉRABLE, François-Henri, Évariste, 2015, Gallimard, Paris, p.165
La haine préfabriquée
Ce matin, M. Arthur, vous avez mis du beurre sur votre pain. Le café roucoulait dans la cafetière tandis que vous lisiez votre journal, tranquille, dans votre bungalow confortable, quelque part dans le monde, à l’abri. Vous avez peut-être mis du lait dans votre café, et en regardant le nuage se former dans votre tasse, vous vous êtes dit : c’est beau.
Vous êtes une personne bien ordinaire, M. Arthur. On peut penser que vous avez fait vos premiers pas en célébrant votre premier anniversaire et que quelques mois plus tard, votre mère était fière de dire à ses amis que vous aviez baragouiné vos premiers mots. Le Québec ne savait pas encore qu’il le regretterait bientôt.
Remarquez, je suis affligé de me dire que si ce n’était pas vous, c’en serait un autre. Et puis d’ailleurs, vous n’êtes pas seul. Vous appartenez à une armée de rhéteurs du mépris, le fiel au bout des lèvres dans vos cris étouffés, comme si vous l’étiez vraiment : excédé, enragé, outré. Parce que c’est le rôle que vous incarnez, sitôt assis derrière votre micro, quelque part dans le monde, à l’abri. Celui qui n’en peut plus de la petite misère, celui qui voudrait la mort symbolique des marginaux, des laissés-pour-compte, des gens ordinaires qui osent revendiquer un monde meilleur. Il vous suffit de les associer à la gauche (qui n’est pas une maladie), aux extrémistes (qu’ils ne sont presque jamais) pour que votre haine trouve sa justification.
Vous êtes un kapo. Un de ceux qui ont choisi le parti du pouvoir. Pour vous ce n’est qu’un show, une façon comme une autre de faire du cash. Vous êtes cynique jusqu’à la moelle et vous réclamez de l’adage odieux qu’il faut diviser pour régner. Vous semez la pagaille avec vos propos incendiaires et vous vous signez. Vous sortez du studio, saluez votre équipe le sourire aux lèvres. Vous êtes un homme gentil, au fond. Et puis vous regagnez votre bungalow, au-dessus de tout, comme si tout ce monde ne vous concernait pas, parce qu’il faut bien gagner sa croûte et qu’heureusement, il y a un dicton qui nous rappelle qu’il n’y a pas de sot métier.
En arrivant à la maison, vous vous lavez les mains de la même eau que Ponce Pilate. Vos doigts ne sont pas crasseux pourtant, il n’y a que votre langue qui soit sale, elle qui n’a fait que ça tout le jour durant : brasser de la marde. Votre réputation est peut-être entachée, certes, mais qui n’a rien à se reprocher, pensez-vous.
Et le soir vous vous glissez dans vos draps, et vraiment à ce moment je ne sais pas comment vous faites. Seul dans la noirceur, votre bungalow plongé dans le silence, le calme. Cette fois seul avec votre conscience, votre journée derrière vous, vous gagnez doucement le sommeil dans le décompte des moutons.
Pas un instant vous ne songez que ce qui a mis du beurre sur votre pain, c’est le mépris. Vous ne songez pas que votre patron ne vous apprécie que parce que vous avez l’audace de traîner les innocents dans la boue, de leur infliger une violence gratuite et, au moment où on attendait de vous des excuses, d’en rajouter.
Pas un instant vous ne songez à ces femmes que vous avez méprisées, les stigmatisant dans votre indifférence. Parce que vous n’êtes pas idiot, vous savez que le portrait que vous avez imagé ce jour-là, c’est celle d’une folle sans dent qui valait tellement rien qu’elle voulait faire une pipe à André Arthur pour 5$. Cette femme, pour vous, n’existe pas. Et ces femmes, dans votre discours, ne valent rien.
Vous savez qu’il y a des gens qui souffrent injustement, que vous seriez le premier à réclamer justice si ça devait arriver à votre fille, à votre sœur, mais à quoi bon vous y intéresser? Le monde est un show qui ne dure qu’une vie, aussi bien en tirer le maximum, quitte à ce qu’on aille un jour cracher sur votre tombe.
Hélas, vous n’êtes pas seul, M. Arthur. Un autre que vous ferait pareil, peut-être même qu’il irait plus loin encore. Mais ça n’enlève rien au fardeau de votre responsabilité. Et puis je ne crois rien de ce que vous dites. C’est impossible votre histoire, c’est une fabrication. J’ai fait la somme de vos propos, j’ai écouté vos sornettes en boucle, j’ai reconnu vos mécanismes éhontés et je me suis rendu à l’évidence : vous ne valez même pas 5$.
Le pénis dévot
Chère maman,
Je ne me souviens pas d’une fois où je t’aurais dit : Maman, cette semaine j’ai mangé un pénis. C’est pourtant ce que j’ai fait hier. Je sais que tu as toujours été ouverte d’esprit, et puis d’ailleurs ne t’en fais pas, c’était un tout petit pénis d’à peine un an. Et encore, il était mort, déjà.
Tu sourcilles peut-être en lisant ces lignes, et pourtant tu n’as rien dit l’autre jour, quand j’ai mis des couilles dans ton assiette. Tu les as même mangées sans prendre ton couteau, en m’avouant étonnée : C’est bon! C’est qu’au Lili co., il faut toujours faire confiance aux invitations souriantes de Catherine Draws, qui connaît le talent de son amoureux de chef, David Pellizzari.
Je passais par hasard devant le restaurant avec une amie. En tournant le coin de Villeneuve, mon estomac a grouillé. Tu sais comme il a des yeux tout le tour de la panse, mon estomac. J’ai donc écouté mon gros instinct, pénétrant dans le repaire chaleureux du Lili co. Dans l’air se mêlaient le chuintement des voix et des arômes d’épices, adoucies par une touche d’acidité. Du kimchi, peut-être. Derrière le comptoir, un grand blond et une belle brune nous ont accueilli les bras ouverts grand comme ça. Oui, grand comme l’achigan que t’as sorti de la rivière Rouge, cet été.
Aussitôt assis, le grand blond – qui était beau, aussi – nous a dit qu’il y avait un incontournable, ce soir-là : un pénis de veau braisé, dans un ragoût de saucisse habanera et de palourdes savoury, sous un lit de feuilles de moutarde et une pluie fine de chapelure. J’ai dit bravo, et aussi qu’en guise de préliminaires, je prendrais les amourettes d’agneau. Au comptoir, mes voisines m’ont fait un long regard, dont on n’aurait pu dire s’il était sévère ou curieux. J’ai pensé : Que ceux et celles qui n’ont jamais mangé de pénis me lancent la première pierre. Je leur ai fait un clin d’œil et je n’ai rien dit.
Les couilles étaient savoureuses. Accompagnées de radis, servies frites, nappées de miel chaud et d’aïoli, c’était difficile de ne pas penser aux McCroquettes. Je le dis sans vulgarité, de toute façon c’était bien meilleur qu’au McDo. Les couilles fondaient sous le palais et à chaque bouchée, c’était plus fort que nous, on en redemandait : Oui! Encore!
En attendant le plat de résistance, la belle brune m’a montré des photos du pénis de veau. Des organes à faire rougir un taureau. Quatre ou cinq pénis de veau longs et élancés gisaient dans une chaudière, telles des anguilles blêmes, avec un gland qui avait tout du pénis humain. À l’échelle, c’était identique. Ça m’a fait un peu drôle de jeter un coup d’œil à ces photos avant de manger, un peu comme on regarderait un album de photos de notre blonde quand elle avait deux ans, juste avant de lui faire l’amour.
Le plat se présentait cependant en toute pudeur. L’audace du pénis sur le menu suffisait : inutile d’en ajouter. C’était comme faire l’amour sous les couvertures, la lumière fermée, les yeux bandés. C’est plein de surprises et le plaisir n’appartient pas aux yeux, mais au toucher, à l’odorat, au goût. Le pénis de veau, ainsi apprêté, évoquait le gras de bœuf. Offrant d’abord une légère résistance sous la dent, il fondait dans la bouche sous les élans répétés de la langue. La couche braisée produisait par ailleurs un heureux contraste de texture. Soumis à la chair vive et épicée des saucisses, baignant dans le jus de bœuf, le pénis s’est avéré un ajout de taille au plat. Et puis, adoubé à la pulpe moelleuse des palourdes, il travaillait fort pour stimuler l’orgasme. C’était excellent sans être orgasmique : une baise honnête avec qui on dort en cuillère.
Plus jeune, dans notre 4½ à Ahuntsic, dans nos chambres séparées par un petit mur de carton, je me souviens t’avoir réveillée pour moins que ça, en faisant l’amour. Mais là, si tu es libre la semaine prochaine, je t’invite au Lili co, maman. Parce qu’en un tour de main, David Pellizzari fait de la magie avec tout ce qu’il touche. Même un pénis.
Le soleil au bout du tunnel
J’ai passé la dernière semaine sur L’Isle-aux-Coudres, je vous l’ai dit. Ici, il n’y a rien qui ne soit parfait. Cette marche le long du fleuve qui s’éternise dans le plaisir qu’on y prend, le repas de quelques oiseaux qu’on n’ose déranger, le soleil qui s’étend dans les feuilles multicolores sur la rive en face, et toujours ce calme, celui du fleuve qui vient caresser la grève, métronome des heures. Parfait, je vous dis. Et encore, je ne vous dis rien de ce ciel d’étoiles, la nuit venue.
Les jours passent et la proximité de l’eau m’est chère. Apaisante. Je suis chanceux d’être là. Et je pense à ces histoires qui m’ont fasciné dernièrement. Ces gens qui n’ont jamais vu la mer. Et je ne vous parle pas d’un Ladhakpa dans les montagnes ni d’un Toubou dans le désert, mais des gens qui ont grandi dans une ville portuaire.
Vous avez peut-être été voir l’exposition de Sophie Calle au Musée d’art contemporain, un peu plus tôt cette année. Vous vous rappellerez alors la seconde partie de l’exposition, où des projections vidéo nous montraient des gens observant la mer pour la première fois. Ces gens de tous les âges étaient Stambouliotes et ont grandi, est-ce nécessaire de le rappeler, sur les côtes du Détroit du Bosphore, qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. Il m’était fou de penser que nous pouvions vivre si près de l’eau, de tant d’eau, et ne jamais s’y rendre.
La réponse à ma stupéfaction m’est peut-être apparue à la une du Devoir, quelques semaines plus tard : la pauvreté. On y rencontrait, par les mots, Marie Thane, mère monoparentale de deux enfants, habitant à Port-au-Prince. L’article relatait le quotidien de cette petite famille et les sacrifices que devait faire Marie Thane pour joindre les deux bouts. Elle qui avait grandi à Port-au-Prince – capitale haïtienne sur les côtes de la Baie de Port-au-Prince qui rejoint plus loin le Golfe de la Gonâve – n’avait vu la mer qu’une seule fois. Elle s’en souvient comme « l’une des plus douces sensations qu’elle ait éprouvées de sa vie ». La mer a beau être juste là sur la carte, dans le fatras des jours et les impératifs d’un ventre qui crie, elle est parfois loin. Très loin.
Aujourd’hui est un jour ordinaire. Ce n’est pas la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté ou celle de la paix dans le monde, non, simplement un jour comme un autre pour ces gens qui triment. Un jour de plus pour ces gens d’ici et d’ailleurs qui font de leur mieux dans un monde qui leur donne peu de chance.
D’autres, heureusement, essaient de les aider. Depuis bientôt trois semaines, cinq Québécois ont entrepris le projet de parrainer une famille syrienne. D’autres suivront sûrement. En attendant, il y a cinq personnes qui ont besoin d’un coup de main, pour les aider à donner un grand coup de main. Je sais qu’il y a beaucoup de gens dans le besoin. Mais sommes-nous des êtres d’une seule cause? Je nous invite à les soutenir.
Vous pouvez en savoir davantage en suivant ce lien (ou celui de leur page Facebook).
Le dernier rodéo du cowboy

Monsieur le Premier ministre Harper,
An english message will follow.
Je suis de cette génération qui a construit son humour en écoutant les albums du peuple de François Pérusse. Lorsque je parle de politique fédérale, il y a cette petite voix qui joue dans ma tête, me rappelant ce sketch du contrebassiste qui ne peut pas jouer aussi bas que la politique fédérale, sans quoi il brisera son instrument. En tant qu’homme de troisième génération de souverainistes, la politique fédérale est toujours un peu déprimante.
Grâce à vous, cependant, l’élection de ce soir revêt un caractère tout spécial, et je tenais à vous féliciter pour le travail que vous avez accompli pendant vos quatre mandats de premier dévot de votre chère reine. Je me souviens qu’à chacune de vos réélections, il y a des gens dans le camp souverainiste qui saluaient votre retour, croyant que vous étiez l’ingrédient manquant au soulèvement populaire québécois contre cette damnée fédération. Et pourtant.
Nous voilà quelque neuf ans plus tard et il me semble qu’au contraire, vous êtes à ce jour le plus grand unificateur du Canada. Lorsque mes amis ont quitté le pas de ma porte hier, ils ont scandé, mi-rieurs : « All in for Justin ». Rassurez-vous, personne n’a l’intention de voter pour le parti Libéral aujourd’hui, mais de penser qu’une grande partie de la population québécoise espère qu’un Trudeau soit élu en dit long sur le traumatisme qui habite présentement la province. Il semble pourtant que nous en soyons rendus là.
Il faut souligner aussi l’inspiration que vous êtes pour plusieurs politiciens québécois. Votre mépris de la social-démocratie, qui guidait depuis plusieurs décennies nos décisions, ainsi que votre arrogance ont été récupérés par M. Couillard et ses sbires. Votre héritage, avec les gens que vous avez mis en place dans l’appareil démocratique, semble pérenne.
Je vous écris ces mots, mais je vous assure que je ne suis pas amer. J’entrevois même cette soirée électorale avec délice. Après tout, il s’agit de fêter votre départ. Et comme le disaient nos aïeux : Rien n’est gagné, mais c’est toujours ça de pris.
Dear Mr Harper,
Today is a very important one for us, so I thought I would take the time to address you these words in your own language. I just wanted to make sure that you had your things packed at the 24 Sussex. The moving truck will be there tomorrow, at 8am sharp.
Farewell,
Yannick Marcoux
 Brûler dehors – Flavie
Brûler dehors – Flavie




